Il y a un an, le Grand Lyon avait publié une étude-manifeste sur la « métropole servicielle« .
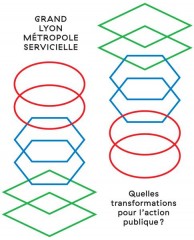
Dans sa publication interne « Prospective 2016 : retour sur les réflexions qui ont marqué la métropole », la Direction de la Prospective du Grand Lyon nous a demandé de donner notre avis sur cette étude.

Résultat : un petit texte d’une page, « La ville servicielle à tout prix » (avec un point d’interrogation dans la version d’origine !), dont on trouvera ci-dessous les principaux extraits.

En s’affirmant comme « métropole servicielle », le Grand Lyon affiche son ambition de mettre l’usager au cœur de ses actions, en passant d’une logique d’offre à une approche orientée solutions. Par exemple, dans le domaine de la mobilité, l’idée est de dépasser la multiplicité des autorités organisatrices de transport sur un territoire pour permettre à l’usager d’avoir une même information, des horaires coordonnés et un seul billet, quelle que soit la diversité des modes de transport (bus, tramway, TER, etc) et des opérateurs. La ville servicielle consiste également à prendre acte que l’habitant/consommateur/usager devient producteur, et ce de manière particulièrement marquée dans le secteur de l’énergie (cf. les bâtiments à énergie positive), ou dans l’économie du partage qui révèle et exploite les actifs sous-utilisés (covoiturage, partage de domicile, crowdfunding…). C’est le premier intérêt de ce rapport que d’organiser l’analyse des mutations en cours, qui sont autant sociétales qu’environnementales ou liées à la révolution numérique.
Son deuxième intérêt, majeur, est de s’interroger finement sur les transformations qu’une telle orientation entraîne pour l’action publique – c’est d’ailleurs le sous-titre du rapport – car « la ville servicielle est une ville qui renouvelle la manière dont le service est conçu, produit et consommé ». Dans un contexte d’ « affaiblissement de la limite service public / service privé », plusieurs pistes sont évoquées. Par exemple, la collectivité « doit le plus possible, quand c’est nécessaire, réguler son écosystème, là par l’incitation, ici par la participation et l’expérimentation avec des partenaires privés, là encore en invitant les usages à coproduire les services, etc » (page 14). Il peut également s’agir de produire des données et de confier à des acteurs privés le soin de les diffuser via des « licences d’utilisation qui permettent d’en encadrer les usages de sorte que la collectivité s’assure que les services développés sont conformes à ses politiques publiques » (page 28). Le rôle de l’acteur public peut être aussi de crédibiliser une offre de partage, de covoiturage par exemple, en apportant de la confiance (page 32). Il s’agit enfin de mettre en place de « nouveaux agencements entre l’offre de services de « nouveaux entrants » (qui sont parfois des particuliers) et celle des opérateurs historiques » (page 39).
Mais jusqu’où la ville peut-elle être servicielle ? Car le rapport insiste sur la transformation des services, en l’occurrence des « services publics » en « services au public », mais il ne va pas jusqu’à poser la question de la transformation d’objets urbains en services. Alors que le rapport fait explicitement référence à l’économie de la fonctionnalité et en rappelle le principe (accéder moins à la propriété de l’objet qu’à ce qu’il permet : par exemple du kilomètre roulé, plutôt que des pneus), il se limite à aborder le service du logement via la question de l’information qui est donnée aux habitants. Mais peut-on imaginer que, demain, l’objet logement (x m2 achetés à tel endroit) se transforme en un « service de l’habiter », qui reste à préciser (x années de droit d’usage d’un logement comprenant également les consommations énergétiques et d’eau et l’accès à l’école, à la piscine et à x spectacles ?). Même si les réflexions sur le « building as a service » sont encore balbutiantes, la question mérite d’autant plus d’être posée que l’hybridation entre les secteurs pousse ce type d’approche et que toutes les voies permettant de produire du logement abordable doivent être examinées.
On touche ici à note deuxième interrogation : quel est le coût de la ville servicielle et qui la paye ? Force est de constater que la ville est aujourd’hui davantage payée par le contribuable que par l’usager. Mais qu’en sera-t-il demain dans un contexte de finances locales contraintes ? Et comment faire que ce qui ne sera plus payé par le contribuable ne se répercute pas sur les usagers, au risque de produire une ville à deux vitesses, « low-cost » : des services de base pour tous, et des services supplémentaires ou de meilleure qualité contre supplément de prix, … bien éloignée de l’objectif d’une ville servicielle « pour tous ». Or, plusieurs des tendances qui sous-tendent cette ville, et que le rapport rappelle, impactent son modèle économique. Par certains aspects elle coûtera moins cher : l’économie du partage permet de générer des recettes pour les habitants-usagers qui mettent leur bien à disposition, mais aussi, potentiellement, pour des collectivités qui peuvent compter sur l’effacement des pics de circulation pour éviter de construire une troisième voie sur une rocade. A contrario, les nouvelles infrastructures que nécessite cette ville (« capteurs, réseaux, véhicules, voies de déplacement », etc. Cf. page 34) devront être financées, alors même que les bases fiscales de la collectivité risquent de se réduire sous l’effet d’une économie du partage largement non fiscalisée. Enfin, la capacité qu’offre le numérique de « calculer au plus près », selon l’expression de Dominique Cardon, permet d’imaginer des systèmes de facturation selon l’usage et selon l’usager et laisse augurer de profonds bouleversements (et débats) dans les systèmes de tarification des services (aux) publics. Eclairer ces transformations des modèles économiques : c’est la prochaine étape.