Quel est le point commun entre l’attention portée aux espaces publics, la piétonnisation, les métropoles, les éco-quartiers, la gentrification, ou encore les jeux Olympiques ? Réponse : tous ces exemples seraient des effets du néolibéralisme qui saisirait les villes. Depuis 2010, on avait compris en lisant Oliver Mongin que « le néolibéralisme n’est pas le tout marché, c’est l’Etat qui se met au service du marché » (Interview dans Télérama). Le récent ouvrage de Gilles Pinson (La ville néolibérale, PUF) nous permet d’aller plus loin dans la compréhension de ces théories qui irriguent de plus en plus la pensée sur la ville en France, que l’on songe aux ouvrages traduits en français de David Harvey ou Mike Davis, à certains travaux académiques (Vincent Béal, Max Rousseau) ou moins académiques, ou encore à des documentaires (« Mainmise sur les villes » sur Arte, de Claire Laborey).
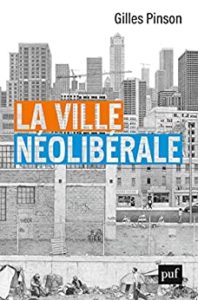
L’ouvrage de Gilles Pinson, d’une très grande clarté, permet d’abord de présenter les différentes lectures critiques du néolibéralisme : une première considère qu’il est poussé par les banquiers d’affaires et consorts, une deuxième qu’il est favorisé par les Etats, une troisième qu’il correspond à une rationalité diffuse, enfin une quatrième, portée par les tenants de la « géographie critique », synthétise ces trois courants et fait de l’impact du néolibéralisme sur la ville son objet central.
Surtout, Gilles Pinson montre comment les politiques, les formes et la démocratie urbaines ont été touchées par le processus de néolibéralisation (voir figure ci-dessous).

En particulier, les grands projets urbains seraient « l’expression idéal-typique d’une néolibéralisation de l’urbanisme » : « ils incarnent le passage d’une ambition de régulation et de distribution à une optique de développement et d’attractivité » ; ils sont des « instruments cruciaux dans la lutte concurrentielle pour attirer les capitaux et les consommateurs » ; « ils contribuent à accélérer les phénomènes de polarisation sociale ». Les praticiens des projets urbains, élus, techniciens des villes, aménageurs, promoteurs, urbanistes, apprendront ainsi que leur travail participe de facto d’un agenda néolibéral ! Cette lecture pourra faire sursauter quelques lecteurs, mais la conclusion de l’ouvrage les rassurera, dans laquelle Gilles Pinson souligne les limites des théories sur la ville néolibérale. Outre une définition confuse de leur objet, elles s’appuient sur une description trop partielle de la réalité : elles « se fondent sur une description de ce que seraient devenues les villes et les politiques urbaines qui souffrent de tellement d’exceptions qu’elles en perdent de leur crédibilité ». Elles présentent enfin des failles analytiques, en « construisant un ennemi omniprésent et omnipotent ». Or cette omniprésence (« le néolibéralisme est partout : dans la gentrification, la compétition entre villes pour organiser des grands événements, la spéculation immobilière, mais aussi dans la vogue de la démocratie participative, la Politique de la Ville ou les éco-quartiers, etc ») pose problème, tout comme cette omnipotence (« tendance à voir dans le néolibéralisme la cause de tout ce qui change – pour le pire généralement – dans les villes »), qui « dispense de réfléchir à d’autres facteurs de changements ».
Certes, Gilles Pinson souligne aussi en conclusion que la notion de néolibéralisme est un « outil politique et militant [, qui] a avant tout pour vertu d’armer intellectuellement les forces de la résistance face à des changements jugés délétères ». Mais on aurait justement aimé qu’il décrive la boîte à outils que nous proposent les tenants de la ville néolibérale. Faute de quoi, il nous semble qu’on ne comprend pas bien en quoi cette approche outille l’analyse, et pas seulement propose une interprétation, des évolutions de la fabrique urbaine. Permettons-nous ici d’exprimer un point de vue : il nous semble qu’il y a un décalage entre des analyses de terrains fines et documentées, qui fournissent effectivement une lecture critique intéressante des processus urbains à l’œuvre (on pense ici aux travaux de Rachel Weber sur la « financiarisation » de Chicago, ou à ceux de Max Rousseau sur le marché du loft à Roubaix), et une montée en généralité, qui mettant tous les acteurs « dans le même sac », nous semble inaudible pour ceux qui, au quotidien, travaillent avec une pluralité d’acteurs, aux logiques d’intervention a priori différentes (mais peut-être pêchons-nous par une « vision irénique » ou « urbano-béate » (pages 26 et 27)).
On rejoint ici l’interpellation, particulièrement stimulante, de Gilles Pinson en conclusion : « les théories de la ville néolibérale aident[-elles] vraiment ceux qui veulent lui résister » ? On se permet ici de suggérer une piste. Il nous semble que, si on veut avoir une analyse qui ait prise sur les acteurs publics et privés qui fabriquent la ville, il est indispensable de montrer la pluralité des acteurs, notamment privés, qui interviennent dans la ville. Cette diversité est liée à la fois à leurs caractéristiques propres (un fond de LBO et une entreprise de l’économie sociale et solidaire sont par exemple deux acteurs privés qui ont peu de choses en commun), mais aussi à la diversité de leur mode d’interaction avec les acteurs publics locaux (notamment champ de la commande publique ou du droit de l’urbanisme). Il s’agit aussi d’embrasser de manière extensive l’ensemble des acteurs de la ville. Alors que les acteurs privés évoqués par les tenants de la ville néolibérale se réduisent essentiellement aux promoteurs immobiliers (Gilles Pinson cite aussi les « banquiers d’affaires », et, en creux (page 142), les opérateurs des secteurs du transport et de l’eau), l’irruption des plateformes numériques, qui ciblent directement l’habitant-usager et peuvent intervenir sans l’aval de la collectivité, posent de nouveaux défis inédits.
Un livre à lire !
Extrait :
Ces thèses de la ville néolibérale ont une indéniable puissance de dévoilement. Elles offrent un contrepoint à tous les discours – savants, politiques ou journalistiques – porteurs d’une vision irénique du renouveau des villes et des politiques urbaines qui fleurissent depuis quelques années ([par exemple Richard Florida et Edward Glaeser]). Qu’ils célèbrent la redécouverte du patrimoine urbain, la réinvention d’un urbanisme soucieux des traces de la ville, le triomphe d’économies urbaines qui valorisent davantage la matière grise que les matières premières, la supériorité morale des habitants des villes plus tolérants et plus préoccupés par leur empreinte carbone que leurs congénères périurbains, ces discours ont en commun de ne pas faire le lien entre le nouveau « moment urbain » que nous vivons et les profondes transformation du capitalisme qui l’ont suscité. Cette vision irénique sature le discours sur le « projet urbain », cette nouvelle pratique de l’urbanisme rompant avec l’urbanisme fonctionnaliste, désireuse de « refaire la ville sur la vile », de suturer les lambeaux de ville déchirés par les infrastructures et attentive à la qualité des espaces publics. On retrouve cette même vision dans les discours autour du développement urbain durable qui font de la ville et ses attributs – la densité, la concentration d’activités économiques à forte valeur ajoutée supposées avoir un moindre impact environnemental, etc. – la solution aux enjeux environnementaux. Plus récemment, c’est la thématique de la ville intelligente qui a repris le flambeau des discours enchantés sur la renaissance urbaine.
La connexion établie par les thèses de la ville néolibérale entre changements économiques, politiques et idéologiques d’une part et transformations urbaines d’autre part, est plus que bienvenue pour nous sortir du prêt-à-penser « urbano-béat » qui irrigue parfois les discours des intellectuels et des praticiens spécialistes de la ville.