Informer sur le financement de la ville

Assurément l’an prochain, nous les ferons plancher sur un « commentaire de kiosque », avec, à l’appui, cette photo prise rue Cadet à Paris avant-hier (quelques heures avant que nous intervenions devant des annonceurs réunis par JCDecaux pour leur présenter notre livre sur le trottoir !).
Ici une vidéo du même kiosque prise ce 8 février 2024 :
Déjà, cette photo/vidéo donne à voir une jolie mise en abyme du trottoir (le kiosque est sur un trottoir et, au milieu en bleu, une affiche de la Ville de Paris sur le Code de la rue indique : « le trottoir c’est pour les piétons »). Mais c’est surtout l’affiche de droite qui nous intéresse, qui indique : « La communication des marques finance ce kiosque pour mieux vous informer. JCDecaux ». Elle rappelle ainsi que la création du premier abribus publicitaire à Lyon en 1964 a moins été l’invention d’un nouveau mobilier urbain que l’invention d’un nouveau modèle économique, où l’abribus et son exploitation sont gratuits pour la collectivité car financés par les annonceurs.
Cette affiche rejoint une de nos convictions : la question du qui paye la ville est un sujet éminemment politique (au sens noble du terme) et doit être débattue sans a priori et de manière à la fois experte et pédagogique. C’est ce que nous avons par exemple cherché à faire dans nos publications sur « La ville restera-t-elle gratuite ? » (article dans Futuribles en 2015), ou récemment dans l’étude « Transparence sur les ZAC » pour Idhéal, ou encore dans la présentation du financement du projet urbain Bercy Charenton, ou lors du Grand débat sur la fabrique de la ville à Nantes.
Or la gratuité de la ville est en plein bouleversement sous l’effet du numérique. Alors que la gratuité dans la ville était largement fondée sur le couple usager-contribuable (c’est gratuit pour l’usager car financé par le contribuable local), voire sur le triptyque usager-contribuable-consommateur (c’est gratuit pour l’usager et le contribuable car financé par le client de l’annonceur), le numérique rebat les cartes de la gratuité.
Ces réflexions nous passionnent depuis qu’en 2007, Denis Olivennes, qui dirigeait alors la Fnac, avait publié ce livre qui avait eu un important retentissement : « La gratuité c’est le vol ». À l’époque, les industries du livre et du disque avaient déjà été saisies par le numérique et l’auteur dénonçait le fait que le piratage, ou la « culture de la gratuité », « tuait la culture ». Ce piratage résultait, d’une part, de la possibilité d’échanger des fichiers à coût nul, d’autre part de l’idéologie cyberlibertarienne qui caractérise un certain courant des débuts d’Internet. L’auteur distinguait cette gratuité de celle des médias traditionnels dont la gratuité de l’usage est en réalité financée par la publicité. En 2024, le piratage pour la musique et, désormais, les films, n’a pas disparu mais il a été atténué avec l’essor du streaming.
Désormais, l’enjeu de la gratuité à l’heure du numérique se joue d’une autre manière, et l’exemple le plus emblématique, et interpellant, nous semble être celui de Google Maps.
L’outil cartographique de Google Maps est par exemple gratuit pour le piéton qui, depuis son smartphone, consulte un plan pour se diriger vers sa destination. Initialement, Google Maps était également gratuit pour le commerçant, ou autre acteur, qui insère une carte personnalisable sur son site, pour indiquer sa location. Mais désormais, cette gratuité est conditionnée au fait de ne pas dépasser un quota d’utilisations : si ce nombre est dépassé, soit la carte devient inaccessible, soit l’utilisateur qui veut mettre la carte sur son site doit payer.
Les autres recettes proviennent notamment d’une part, des annonces (publicités) faites par des annonceurs (restaurants, commerces) situés à proximité de l’adresse recherchée (ils apparaissent quand l’internaute clique sur « à proximité ») ; et, d’autre part, des « pins » promotionnels, qui peuvent apparaître selon divers tarifs et diverses modalités (par exemple, lorsque l’internaute zoome sur la carte). Une autre source de recettes provient de l’affichage sur le côté de la carte d’une liste de produits vendus dans le magasin.
La gratuité telle que la propose Google Maps est donc une combinaison entre d’un côté le modèle « freemium » où l’offre de base d’utilisation d’une carte jusqu’à un certain quota est gratuite, celle premium est payante ; et de l’autre le modèle économique des plateformes multi-faces (elles ont plusieurs « faces » de clients qui se potentialisent : plus il y a de clients sur une face, plus cela permet d’en avoir sur l’autre face). Dominique Cardon le résume de la manière suivante : « La gratuité est la stratégie commerciale d’un modèle économique qui monétise sur un autre marché le volume et l’activité d’utilisateurs qui ne payent pas ».
Source : notre article pour la Direction de la Prospective de la Métropole de Lyon sur l’évolution de la manière dont le numérique saisit les villes.
Ce modèle économique a deux conséquences. D’abord, il semble que le « gratuit » fonctionne comme une « cape d’invisibilité » : alors que des plateformes comme Uber et Airbnb ont fait l’objet de nombreuses polémiques, Google Maps est jusqu’à présent largement passée sous les radars, alors même qu’elle pose des questions sur la représentation des villes, qui est un puissant instrument de pouvoir : voir le passionnant article de VraimentVraiment : « Espace public : Google a les moyens de tout gâcher et pas qu’à Toronto ».
Deuxième conséquence : la gratuité présente le risque de rendre la plate-forme incontournable. Au fur et à mesure que la plateforme gagnait des utilisateurs, elle a ainsi réduit ses offres gratuites. Le modèle de gratuité a permis de prendre place tout en asséchant l’émergence de concurrents, selon un modèle d’affaire « assez proche des dealers de crack » selon Christian Quest, président d’Open Street Map ! (à lire également dans le même article pour la Direction de la Prospective de la Métropole de Lyon).
Or si Google Maps nous paraît important à décrypter, ce n’est pas seulement comme exemple emblématique de la gratuité à l’heure du numérique, mais c’est surtout parce que l’accès à l’espace public passe de plus en plus par l’accès à l’information sur l’espace public, et cette « couche informationnelle » (comme nous la détaillons dans « la valeur du trottoir » pour le Grand Lyon) est largement opérée par des acteurs comme Google Maps.
Evidemment, l’affiche de JCDecaux renvoie au débat sur la place de la publicité en ville, dont les enjeux viennent d’être bien résumés en 8 minutes chrono par Philippe Gargov (avec qui on partage le goût des trottoirs et des jeux), dans cette vidéo : « Une ville sans pub est-elle possible ? »
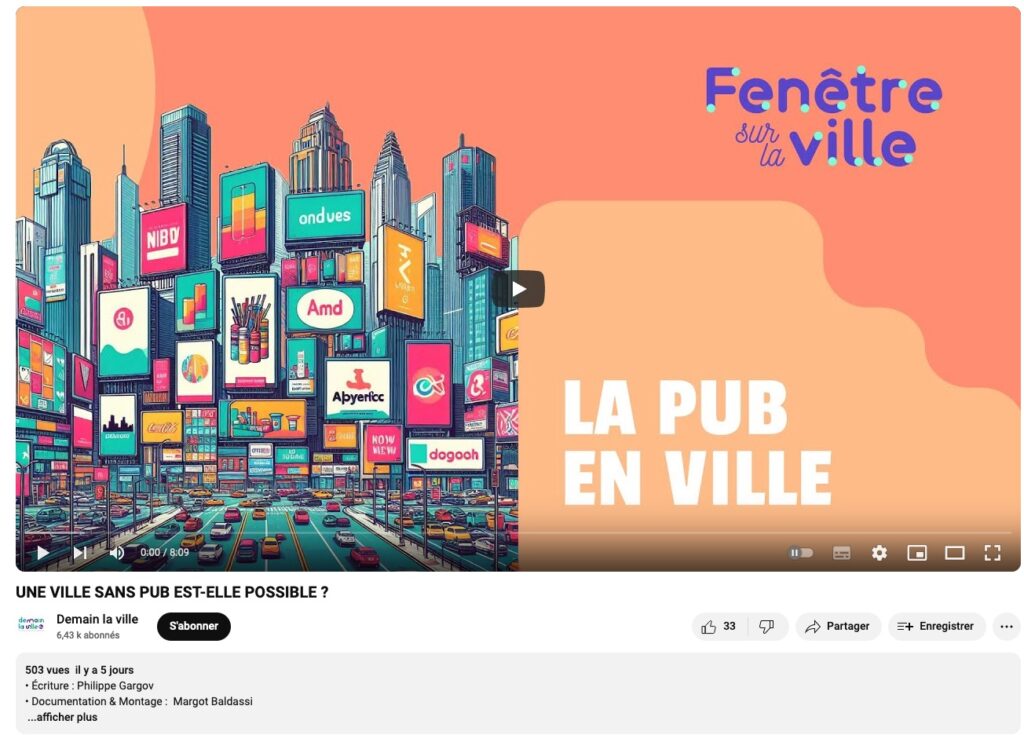
Mais de même que nous enseignons à nos étudiants qu’il n’y pas un acteur privé, mais une diversité d’acteurs privés (cf. aussi ici notre critique de la ville néolibérale), il n’y a sans doute pas une forme de publicité mais des formes de publicité. Et c’est là qu’on retrouve… Google !! A la une des Echos hier, l’article « La publicité digitale s’envole vers les 10 milliards d’euros » (à titre de comparaison le budget 2024 de la ville de Paris est de 11 milliards d’euros) indique : « c’est un mur symbolique que va franchir le marché tricolore de la publicité numérique cette année. (…) L’an passé, le trio Google-Meta-Amazon a battu un record en s’arrogeant 68% du marché publicitaire français, soit la bagatelle de 6,3 milliards d’euros ».

Et si la publicité qui disparaîtrait des écrans des villes réapparaissait sur les écrans des smartphones qu’utilisent les habitants des villes pour « naviguer » dans celles-ci, tandis qu’Amazon est un occupant de trottoir qui ne finance ni leur fabrication, ni leur entretien, ni les externalités négatives qu’il génère (en tout cas en France. La ville de Barcelone a par exemple instauré une « taxe Amazon » – voir la note de Laetitia Dablanc) ?
Bref, le débat sur le financement du mobilier urbain par la publicité est peut-être un peu plus compliqué que ce à quoi on le réduit parfois. Surtout, il s’agit de réinscrire ce débat dans une approche plus large. La question qui se pose est : qui doit payer la ville, et quelle ville ?
Et aussi quelques-uns de nos précédents billets :
- Sur le street marketing
- Sur le mobilier urbain mobile
- Sur le démontage des panneaux JCDecaux en 2018
Et aussi, sur le financement de la ville :
- Sur le financement de la propreté des villes par les fabricants de chewing-gum
- Sur le financement via le naming des noms de rues
- Sur une ville à 90,2% gratuite
- Sur le financement de la rue commune de demain
- Sur la ville saisie par le gratuit
- Note pour le Réseau National des Aménageurs : « La gratuité de la ville« .
Ajout : trottoirs du Cours de Vincennes et de la place de la Bastille le 9 février 2024



