1 octobre 2022
Education, économie et transition
Le dernier numéro de la revue L’Economie politique est consacré à l’enseignement, la transition et l’économie. Forcément, on l’a lu avec intérêt.

Quelques extraits.
Extrait de l’éditorial « Transmettre pour transformer » de la rédactrice en chef, Sandra Moatti
« Nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d’être fiers et méritants à l’issue d’une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d’une planète soutenable. » Lors de la cérémonie de remise de leur diplôme, le 30 avril dernier, un collectif d’étudiants d’AgroParisTech appelait leurs camarades à « bifurquer » et à se détourner des « jobs destructeurs ».
Ce discours n’est pas isolé, même s’il prend parfois des formes moins radicales. Il s’inscrit dans un mouvement de fond chez les jeunes, qui dénoncent les contenus de leurs formations et les parcours auxquels elles les destinent. Comme les étudiants de Mai 68, en plus inquiets face à la montée des périls écologiques et climatiques, ils veulent transformer le système, récusent le modèle productiviste et consumériste, le travail privé de sens. Cependant, ils ne contestent pas l’autorité de leurs aînés, mais leur inaction. Et la révolte ne vient pas de Nanterre, mais des « rebelles » des grandes écoles, purs produits de la méritocratie. En effet, la parole qui s’exprime publiquement est aujourd’hui surtout celle des étudiants de Centrale, Polytechnique, Normale Sup, HEC, Sciences Po… – les mêmes qui, dès 2018, avaient lancé le manifeste « Pour un réveil écologique ». Mais le nombre de signatures recueillies, plus de 30 000, témoigne de l’écho de ces préoccupations.
Cette contestation interroge les finalités mêmes de notre modèle d’éducation. Celui-ci valorise en effet la compétition scolaire et hiérarchise les individus dès le plus jeune âge, sur la base de leur capacité à manier une rationalité techno-scientifique. Cette méritocratie obnubilée par la sélection des élites – qui n’aboutit en réalité qu’à leur reproduction – prend le pas sur d’autres objectifs : la formation de l’écocitoyen, incluant la transmission d’une culture commune sur les enjeux de l’Anthropocène ; la capacité à coopérer ; l’épanouissement de la sensibilité et de l’imagination ; le développement de l’initiative, du libre arbitre et du pouvoir d’agir.
Extraits de l’article « L’environnement, angle mort des formations en économie », de Nicolas Graves
L’enseignement de l’économie dans le supérieur a plusieurs fois été remis en cause depuis les années 2000. En 2014, les étudiants de l’Initiative internationale des étudiants pour le pluralisme en économie (Isipe) ont dénoncé dans une lettre ouverte le fait que les programmes ne traitaient pas des problèmes réels, qu’ils reflétaient une faible diversité intellectuelle et pensée critique.
L’environnement reste un prétexte pour appliquer les modèles vus en cours et les enjeux écologiques ne sont pas abordés en tant que tels. La formation est lacunaire, sinon inexistante, en histoire des faits et de la pensée, en épistémologie et dans les autres sciences connexes. Peu de temps est consacré aux problèmes contemporains et les jeunes économistes peinent souvent à comprendre en quoi leur discipline leur permet de comprendre le monde. Cette situation s’explique par des facteurs à la fois historiques, théoriques et institutionnels.
Un désintérêt historique de l’économie pour l’environnement
Bien que l’économie et l’écologie partagent la même racine étymologique (oïkos, le foyer), l’économie, comme science des activités humaines de production, d’échange et de consommation, reste longtemps disjointe de l’écologie, science des relations des organismes avec le monde environnant, ou plus largement, des conditions de leur existence. Lorsque les bases de l’économie moderne sont posées au XVIIIe siècle, la théorie classique ne retient des ressources naturelles que leur potentiel productif et occulte leur possible épuisement. La posture générale est bien résumée par la célèbre phrase de Jean-Baptiste Say : « Les richesses naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l’objet des sciences économiques. »
Des travaux économiques sur les ressources naturelles et l’environnement apparaissent au cours du XIXe siècle, notamment autour du charbon. Mais la préoccupation occupe une position marginale et se réduit le plus souvent à des problèmes d’allocation des ressources parmi d’autres. Les enjeux écologiques montent en puissance dans les années 1970 et se cristallisent autour de la parution, en 1972, du rapport du Club de Rome sur les limites à la croissance. Celui-ci alerte sur l’épuisement des ressources naturelles. S’appuyant sur un modèle mathématique, il est proche dans sa démarche méthodologique des modèles utilisés par les économistes néoclassiques, tout en étant radicalement différent.
Depuis, et malgré l’intérêt croissant des jeunes et de la société civile pour les crises écologiques, le désintérêt des économistes pour l’environnement persiste. Le rôle de l’énergie dans la croissance par exemple reste majoritairement ignoré. (…)
L’environnement dans l’économie, ou l’économie dans l’environnement ?
Au sein même des économistes qui s’intéressent aux enjeux écologiques, la façon de se représenter les interactions entre économie et environnement diffère. Deux approches principales existent : l’économie de l’environnement et l’économie écologique. L’économie de l’environnement traite les questions environnementales par extension directe de la théorie néoclassique. Elle reconnaît les externalités environnementales et apporte pour leur gestion des solutions souvent centrées sur le marché. Cette approche considère que le problème central est de reconnaître l’environnement à sa juste valeur économique. Dès lors que le système de prix reflète ces valeurs, les calculs économiques des agents aboutissent à une allocation optimale des ressources. Ce passage au monde de la valeur permet de s’affranchir des limites biophysiques, qui sont pourtant bien établies dans d’autres disciplines.
La traduction des réalités physiques en quantités monétaires n’est en effet pas neutre. Dès lors que la nature elle-même devient un « capital naturel », des substitutions entre différentes formes de capital sont possibles. Il n’y a pas de rareté absolue, mais uniquement des raretés relatives. Sous certaines hypothèses (loin de toute considération empirique), les modèles néoclassiques montrent qu’il est possible de croître de manière indéfinie malgré l’épuisement d’une ressource finie. Cette démonstration tient lieu d’objection à l’idée qu’il existerait des limites à la croissance. Elle est doublée d’une prétention à l’objectivité, comme si le calcul économique était garant de neutralité et permettait de s’affranchir des conflits normatifs qui sous-tendent tout choix politique. Dès lors, les travaux des économistes standards n’appréhendent pas assez les questions dites d’économie politique – dans quelles conditions une réforme est adoptée et acceptée – et les enjeux d’inégalités et de redistribution associés. Un exemple emblématique est la taxe carbone, mesure cardinale pour les économistes de l’environnement, dont l’augmentation est à l’origine du mouvement des gilets jaunes.
L’économie écologique considère au contraire que l’environnement n’est pas un « sous-système » que l’on peut intégrer au système économique. Celui-ci est encastré dans un monde biophysique limité, avec lequel il interagit sans cesse. A chaque cycle de production, des ressources sont prélevées et des déchets polluants rejetés.
Cette approche est développée par des chercheurs comme Herman Daly et Nicolas Georgescu-Roegen. L’économie écologique reconnaît ainsi et étudie l’interdépendance et l’évolution conjointe des sociétés humaines et des écosystèmes. Interdisciplinaire, elle intègre les apports de l’écologie ou de la thermodynamique. Emergente depuis les années 1970, cette branche de l’économie permet d’imaginer un monde sans croissance infinie. Et ce n’est pas nécessairement un monde lugubre : l’un des fondateurs de la discipline, Robert Costanza, le souligne à travers le titre de son dernier livre, Vivement 2050 !
Un verrouillage des sciences économiques contesté
Si l’économie écologique se développe, elle reste minoritaire et n’est souvent évoquée que dans les cursus spécialisés associés aux laboratoires utilisant cette approche. Cette position minoritaire est perpétuée par les conditions de recrutement des enseignants-chercheurs. (…). Malgré la signature d’un décret en ce sens, l’opposition de quelques économistes orthodoxes et un courrier de Jean Tirole fin 2014 assimilant le pluralisme à un « relativisme des connaissances » ont suffi pour provoquer un blocage de la décision par l’Elysée [Chavagneux, 2021]. Presque dix ans plus tard, cette situation d’abus de position dominante est toujours en vigueur.
La domination de l’économie orthodoxe à l’université freine la diffusion d’idées nouvelles et transdisciplinaires, nécessaires pour prendre en compte les enjeux d’économie politique associés à la transition écologique. Mais cette situation est de moins en moins tenable. De même que l’incapacité de la discipline à prévoir le krach financier de 2008, sa cécité face aux catastrophes écologiques en cours pourrait provoquer une remise en cause de la manière dont l’économie néoclassique appréhende les contraintes physiques. (…)
Des organisations comme l’Association française pour l’économie politique ou le réseau Economists for Future promeuvent une meilleure inclusion de l’interdisciplinarité et du pluralisme en économie au cœur des enseignements. Les étudiants en économie se mobilisent également : le réseau Rethinking Economics rassemble des groupes d’étudiants sur les cinq continents, et la plate-forme Exploring Economics promeut un apprentissage pluraliste de l’économie à l’université, comme une science traversée par différents courants de pensée, connectée à des disciplines voisines et ancrée dans des grands enjeux contemporains. Gérée par des étudiants, elle propose des centaines de contenus pédagogiques en économie en quatre langues et réunit une communauté dynamique autour d’ateliers, séminaires et universités d’été. (…)
Le groupe de travail piloté par le climatologue Jean Jouzel sur la formation aux enjeux de la transition écologique dans l’enseignement supérieur a rendu ses conclusions en février 2022. Celles-ci indiquent des directions assez claires mais très génériques, ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble de l’enseignement supérieur. Elles portent à la fois sur les enjeux d’organisation et des problématiques pédagogiques.
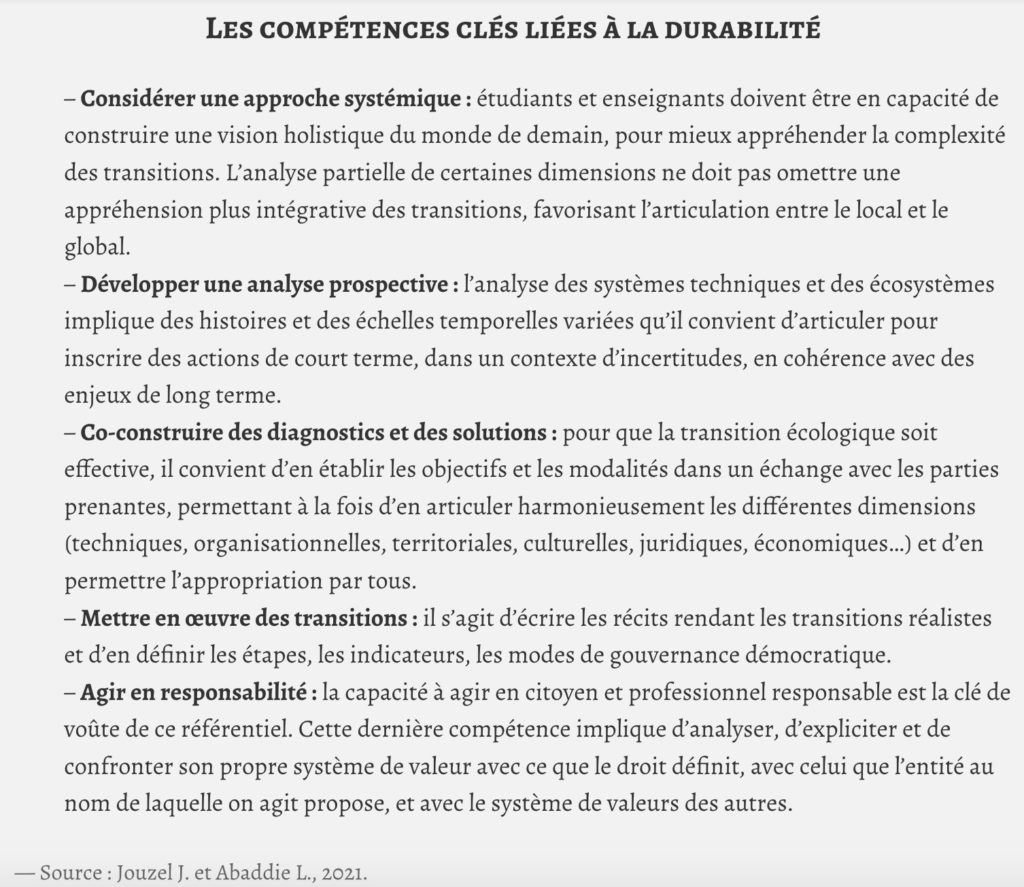
Les recommandations du rapport Jouzel n’ont pas encore été déployées spécifiquement dans chacun des cursus, mais quelques outils et concepts pourraient rapidement se déployer dans les formations en économie.
Les compétences systémiques, de prospective et de diagnostic peuvent être travaillées en s’appuyant sur des outils et concepts économiques existants. Dans le cadre de l’économie orthodoxe, la notion d’externalité environnementale devrait être abordée. Mais d’autres notions doivent être introduites. La tragédie des horizons permet d’expliciter le fait que des risques catastrophiques soient ignorés lorsqu’ils sont susceptibles de se manifester au-delà de l’horizon (temporel ou spatial) des décideurs. La notion d’incertitude radicale (autrement dit, l’impossibilité à probabiliser) aide à saisir les limites d’une approche par le calcul des risques et la recherche d’un optimum, et souligne la pertinence du principe de précaution. Une présence de l’épistémologie dans le cursus peut permettre de prendre du recul sur la valorisation monétaire de l’environnement. L’économie écologique introduit la matérialité de processus économiques. C’est aussi l’apport de l’histoire économique, qui est en outre indispensable pour comprendre la pluralité des voies du développement et pour mettre en perspective certains concepts théoriques ou certaines notions comme celle de « transition ».
La mise en œuvre des transitions elle-même implique une attention particulière aux questions d’économie politique, de distribution des impacts et de compensation des politiques publiques. La gestion des biens environnementaux (air, eau…), qui sont couramment des biens en accès libre et rivaux est éclairée par les débats autour de la « tragédie des biens communs » , l’économie institutionnelle ainsi que les travaux d’Elinor Ostrom. En finance, les notions de risque environnemental sont encore couramment mal traitées. La notion de « double matérialité » gagnerait à se diffuser au sein des cursus : en effet, les risques environnementaux qui pèsent sur les organisations ne peuvent être la seule boussole des entreprises et des investisseurs ; il faut aussi considérer en miroir les risques que les organisations elles-mêmes font peser sur le système biophysique.
Enfin, il n’y a pas une solution clé en main : il est important avant tout de valoriser le recours aux expérimentations dans l’enseignement de l’économie.
Au-delà de ces quelques pistes sur l’ouverture théorique et les contenus académiques, les pédagogies par l’action ont toute leur place pour l’acquisition des compétences de mise en œuvre des transitions et la responsabilisation des jeunes citoyens et des futurs professionnels. Ceux-ci auront à faire face à des problèmes économiques et de durabilité complexes, qu’une approche univoque de la rationalité et du calcul économique ne suffit pas à appréhender.
Extraits de l’article « Ecoles de commerce en transitions, mission impossible ? », de Cécile Renouard (avec la contribution d’Elaïne Vetsel)
Le défi éthique et politique est multiple : comment faire pour que les cursus en finance autant qu’en entrepreneuriat social intègrent de façon structurante la crise écologique ? Comment susciter le désir de s’engager, à sa manière, sans « faire l’autruche » ? Comment relier l’analyse des enjeux géopolitiques et financiers avec l’expérience du vivant concret, et le sort de nos prochains éloignés dans l’espace et dans le temps ? Comment réaliser, avant tout, que nous n’avons pas de planète B – comme on peut le lire sur les pancartes des manifestations pour le climat –, mais que nous avons un seul monde en commun et que nous dansons au bord de l’abîme ?
Faut-il plaider pour la fermeture des business schools, comme l’a fait de façon provocatrice Martin Parker [2018], lui-même étant professeur dans une école de commerce ? Les pages qui suivent consistent à sonder quel type de rupture ou de réforme est possible. L’analyse du fonctionnement actuel des écoles de commerce et des formations en gestion tend un miroir grossissant des contradictions de nos sociétés. Ce diagnostic conduit à s’interroger à la fois sur la possibilité même de viser sérieusement un horizon décarboné à travers ces cursus, et sur la praticabilité des différents chemins de transformation envisageables.
(…)
Les enseignements des écoles de commerce et autres formations en gestion visent à outiller les étudiants afin qu’ils puissent être acteurs, de façon concrète, des organisations dans lesquelles ils seront engagés. Plusieurs visions du management coexistent, et certaines visent à dépasser sa réduction à l’analyse des diverses fonctions qui concourent à la production et aux échanges (marketing, contrôle de gestion, droite des affaires, finance, etc.), pour favoriser une compréhension des ressorts de l’action collective dans les entreprises et plus généralement dans toute institution [Stempak et Eynaud, 2022]. Néanmoins, le tableau d’ensemble est bien celui mentionné plus haut : les cursus n’intègrent quasiment pas les questions écologiques, à commencer par celle du climat. Cette réalité – ou plutôt ce déni de réalité – peut être relié à l’histoire des disciplines, notamment à la manière dont a été conçue l’économie en contexte libéral depuis deux siècles, ce qui a des effets sur les diverses disciplines appliquées des « sciences de gestion ».
Le poids des théories orthodoxes en économie
Le discours économique, qui cherche à définir les règles de la « maison commune », s’est renforcé depuis le XVIIIe siècle à partir de prémisses non démontrées et de silences concernant les dommages sociaux et environnementaux liés à la création de richesses. Ainsi, l’ouvrage d’Adam Smith, La Richesse des Nations, passe sous silence le fait que la prospérité de l’Empire britannique est assise sur le travail des esclaves dans les plantations [Brown, 2010]. Dans Le Second traité du gouvernement civil, Locke défend le droit de chaque habitant à jouir d’un bout de terre qu’il pourra cultiver pour subvenir à ses besoins, en soutenant « qu’il y en aura toujours assez et d’assez bonne [qualité] ». Dans ses Principes d’économie politique, John Stuart Mill met certes en garde contre l’idéal d’un progrès social assis sur la concurrence et l’exploitation sans fin des ressources. Néanmoins, la rationalité techno-scientifique à l’œuvre écrase les voix dissonantes. L’économie est, au cours du XXe siècle, de plus en plus considérée selon un paradigme gestionnaire et quantitatif, loin de la vision, défendue par Mill, d’une économie politique comme « branche de la philosophie sociale », c’est-à-dire conçue comme une discipline parmi d’autres, et devant dialoguer avec d’autres sur l’organisation de la vie sociale et politique dans un monde fini.
Les représentations collectives dans les formations en gestion, en économie et en finance, vont de pair avec la quête utilitariste d’une richesse globale à faire grossir grâce à l’aiguillon de l’intérêt individuel. Dans cette perspective, la finitude des ressources n’est pas questionnée. En comptabilité, la nature n’est pas considérée, comme s’il s’agissait d’une réserve que l’on peut dépenser à sa guise, en quantité illimitée [2]Voir notamment les travaux de Jacques Richard et Alexandre…. Le discours du développement durable tend à occulter les tensions entre gagnants et perdants, et le fait que des gains à court terme peuvent se révéler porteurs de désastres à moyen ou long terme, y compris pour ceux-là même qui en bénéficient. L’ouvrage de Rachel Carson, Silent Spring, dénonçant les ravages de l’industrie sur le vivant, date pourtant de 1962. Bien des voix ont tenté de s’élever avant elle et depuis lors, mais le récit dominant est resté le discours néolibéral des bienfaits majoritaires d’un modèle extractiviste, productiviste et consumériste, source de croissance et de développement.
Les formations en gestion sont, en quelque sorte, le bras armé de cette perspective. Elles nourrissent un aveuglement complet à l’égard des liaisons intimes entre les évolutions humaines et écosystémiques, alors même que celles-ci sont constitutives de la période actuelle de l’Anthropocène où les principales modifications de l’environnement proviennent de l’activité humaine. Plus ces formations restent arrimées à la fabrique du désastre, moins elles parviennent à s’en détacher, à changer de regard pour être en mesure de changer de cap.
Au fondement, se trouve la conception du rôle des acteurs économiques. Les définitions mêmes de l’entreprise contribuent à des modèles orientés par la recherche du profit, celui-ci étant dématérialisé, coupé de ses conditions concrètes de création. En France, la définition de la société commerciale (article 1832 du code civil) décrit des individus s’associant pour faire du profit, sans que celui-ci soit subordonné à l’intérêt général. Plusieurs propositions ont été faites par des juristes [3]Par exemple, Daniel Hurstel ou William Bourdon. Ivan… pour une réécriture de cet article central, mais elles n’ont pas été retenues. Les débats autour de l’élaboration de la loi Pacte ont conduit à une timide réforme de l’article 1833 du code civil, qui inclut désormais la nécessité de « considérer les enjeux sociaux et environnementaux ». Mais rien n’est formellement exigé des entreprises.
Cloisonnement des savoirs et manque d’approche réflexive
Du point de vue des contenus mêmes des enseignements, le bilan est très mitigé : ceux-ci ne fournissent pas nécessairement un accès aux données pertinentes pour comprendre la situation, et ne favorisent pas souvent un croisement des perspectives ni une approche pluraliste pour élaborer analyses et réflexions.
Pour l’instant, le cloisonnement des savoirs est double, à l’échelle des différentes sciences et disciplines, et à l’intérieur même des formations en gestion. Chaque matière des sciences de gestion a son cadre, ses frontières, ses théories, ses études de cas : finance, comptabilité et contrôle de gestion, marketing, stratégie, Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), communication, etc. On observe généralement de faibles interactions entre les différents enseignements, et une occultation globale des conséquences à moyen terme de la crise écologique. Ce cloisonnement perdure dans bien des organisations fonctionnant en silo. Aurélien Acquier évoque de façon limpide le défi actuel, en soulignant que les disciplines de gestion intimement liées à l’Anthropocène devraient s’ouvrir « vers l’agronomie, la biologie, la physique, mais aussi la philosophie et les sciences sociales, et tout ce qu’on pourrait appeler les “sciences écologiques” » [4]Aurélien Acquier, in Stempak et Eynaud (2022), p.126.. Le cloisonnement des savoirs limite de fait le développement d’une compréhension systémique des enjeux de la transition écologique ainsi que la capacité à développer un esprit critique. Pourtant ces compétences sont indispensables si l’on veut parvenir à imaginer, créer et mettre en œuvre des modèles sobres, adaptés, et résilients.
(…)
Il en découle aussi une interrogation concernant les modèles pédagogiques. Jusqu’à présent, les enseignements ont adopté une approche top-down plutôt descendante, à l’image d’un cours magistral académique qui s’adresse particulièrement à l’intellect. Cette approche entretient une attitude passive chez l’étudiant qui ingère les contenus sans être encouragé à les mettre en perspective, les interroger, les nuancer, voire les critiquer. Et les études de cas (business cases) plus interactives, très utilisées dans les écoles de commerce à la suite d’Harvard, sont souvent conçues selon des logiques très liées au business as usual. Ces pratiques ne favorisent pas l’expression d’approches complémentaires plus existentielles et sensibles, qui permettraient de mettre en perspective d’autres dimensions de l’existence, le rapport à la nature et aux milieux vivants, les émotions face aux injustices et aux désastres, etc.
Le diagnostic qui vient d’être posé a laissé de côté les initiatives qui voient le jour, heureusement, dans divers contextes, à la fois dans le monde de l’enseignement supérieur et à ses marges. Parmi les stratégies transformatives développées actuellement, on peut mentionner le travail réalisé par le mouvement Pour un réveil écologique sur les enseignements et parcours en finance ; le travail « the other economy » réalisé par Alain Grandjean, Marion Cohen et leur équipe pour mettre des ressources en ligne relatives à une économie écologique ( theothereconomy.com/fr/), l’initiative ClimatSup Business, conjointe au Shift Project et à Audencia Business School (avec d’autres partenaires académiques et d’entreprises, dont le Campus de la transition) pour proposer un socle de connaissances et compétences en gestion, et plus particulièrement en finance ; le travail réalisé avec le collectif Fortes et le Campus de la transition, pour mettre à disposition d’enseignants-chercheurs, d’étudiants et d’équipes de direction, des ressources aidant à intégrer les questions écologiques et sociales de façon structurante dans les pédagogies, dans la vie des campus, dans les disciplines de gestion.
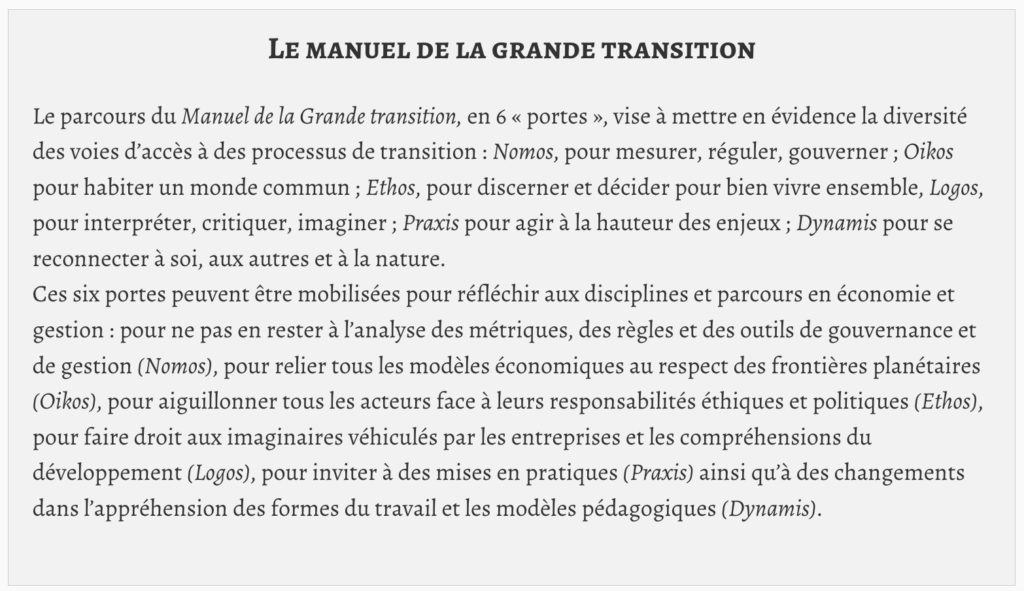
Source : Revue « L’économie politique » numéro 95 – Disponible ici.
A lire également notre billet sur le numéro consacré à comptabilité et écologie : ici.

